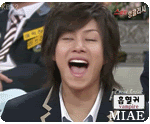skip to main |
skip to sidebar
 Histoire
Histoire
Les premier éventail chinois était en plume, ils utilisent d'ailleurs le même caractère pour désigner les plumes et les éventails[1]. Leurs éventails au IIe siècle était déjà en bambou. Ils furent importés en Europe par les Portugais à partir du XVIe siècle.
L'éventail en Europe [modifier]
Introduit en France par Marie de Médicis, objet favori d'Élisabeth Ire d'Angleterre, il a connu un important développement en Europe aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Produit essentiellement en France, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Italie, ce fut d'abord un objet aristocratique et artistique, reprenant les sujets de tableaux connus tant sur les feuilles que sur les montures d'ivoire, de nacre ou d'écaille.
détail d'un éventail du XVIIIe siècle
Les sujets devinrent souvent moins recherchés avec les bergerades de la fin du XVIIIe siècle, la qualité moindre minorant le prix et facilitant la diffusion de l'objet dans la classe moyenne. Il devint même populaire grâce aux techniques d'impression (parfois même vecteur de propagande politique pendant la Révolution). C'est à cette période qu'il disparut presque en France, pour ne réapparaître qu'avec plus de vigueur après 1830, connaissant un second âge d'or pendant le Second Empire et atteignant sa taille maximale vers 1890.Certains vendeurs d'éventails ont inventé au XIXe siècle pour son maniement un langage très élaboré et codifié.
Il est quelque peu tombé en désuétude pendant l'entre-deux-guerres, hormis en tant qu'objet publicitaire (parfois d'excellente qualité) et hormis aussi dans quelques pays comme l'Espagne, où la fabrication s'était établie moins d'un siècle plus tôt.Il continue d'accompagner quelques personnages iconoclastes de notre époque, symbolisant le désir d'élévation et d'autorité, le refus de la conformité et soulignant l'originalité d'un style.
L'éventail en Asie [modifier]
En Orient, même s'il fut aussi fabriqué au goût européen dès le XVIIe siècle, il est resté un élément essentiel de l'art de vivre et de la culture. Les plus grands peintres chinois ou japonais l'ont utilisé comme support pour leurs œuvres. Objet indissociable les rites traditionnels de la Chine et du Japon, l'éventail est un accessoire fondamental dans le théâtre japonais Nô de même que dans certains arts martiaux.
L'éventail comme arme [modifier]
Éventail d'entrainement
En Chine l'éventail est aussi utilisé dans l'art du Kung fu comme l'arme suprême annihilant le corps et l'esprit.
Il est également présent au Tai-chi-chuan et dans la danse traditionnelle chinoise.
Gunsen
Pendant le Moyen-Age au Japon, le chef de guerre (le shogun) portait un gunsen (littéralement « éventail de guerre ») : ce type d'éventail avait une monture forgée en acier et servait à la fois de signe de ralliement et de direction des troupes (brandi ouvert), et à la fois de garde et de protection (une fois fermé) lors d'un combat au sabre. Le tessen, de forme plus européenne, était plutôt réservé aux femmes.

ลักษณะทั่วไป
ผลมะนาวโดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 – 4.5 เซนติเมตร ต้นมะนาวเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงเต็มที่ราว 5 เมตร ก้านมีหนามเล็กน้อย มักมีใบดก ใบยาวเรียวเล็กน้อย คล้ายใบส้ม ส่วนดอกสีขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอกผลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าแล้ง จะออกผลน้อย และมีน้ำน้อย
มะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จักและใช้ประโยชน์จากมะนาวมาช้านาน น้ำมะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม ผสมเกลือ และน้ำตาล เป็นน้ำมะนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดยังนิยมฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆ เสียบไว้กับขอบแก้ว เพื่อใช้แต่งรส
ในผลมะนาวมีน้ำมันหอมระเหยถึง 7% แต่กลิ่นไม่ฉุนอย่างมะกรูด น้ำมะนาวจึงมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นส่วนผสมน้ำยาทำความสะอาด เครื่องหอม และการบำบัดด้วยกลิ่น (aromatherapy) หรือน้ำยาล้างจาน ส่วนคุณสมบัติที่สำคัญ ทว่าเพิ่งได้ทราบเมื่อไม่ช้านานมานี้ (ราวคริสตศตวรรษที่ 19) ก็คือ การป้องกันและรักษาโรคลักปิดลักเปิด ซึ่งเคยเป็นปัญหาของนักเดินเรือมาช้านาน ภายหลังได้มีการค้นพบว่าสาเหตุที่มะนาวสามารถช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด เพราะในมะนาวมีไวตามินซีเป็นปริมาณมาก
ชื่อของมะนาว
มะนาวก็เหมือนกับส้มทั้งหลาย ที่มีปัญหาในการจัดหมวดหมู่และแยกแยะทางอนุกรมวิธาน สำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ที่ค้นเคยของมะนาว ก็คือ Citrus aurantifolia Swingle หรือ "Citrus aurantifolia" ( Christm & Panz ) Swing." แต่ยังมีชื่ออื่นๆ อีก ดังนี้
C. acida Roxb.
C. lima Lunan
C. medica var. ácida Brandis และ
Limonia aurantifolia Christm
สำหรับชื่อสามัญนั้น ในหลายภาษาก็เรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น ในภาษาอังกฤษ เรียก Mexica lime, West Indian lime, และ Key lime หรือเรียก lime สั้นๆ ก็ได้ สาเหตุที่มีหลายชื่ออาจเป็นเพราะเป็นพืชต่างถิ่น จึงไม่มีชื่อดั้งเดิมในภาษานั้นๆ ทำให้เกิดการเสนอชื่ออื่นๆ มาหลายชื่อก็เป็นได้ ส่วนในประเทศไทยยังเรียกอีกหลายชื่อ เช่น โกรยชะม้า, ปะนอเกล, ปะโหน่งกลยาน, มะนอเกละ, มะเน้าด์เล, มะลิ่ว, ส้มมะนาว, ลีมานีปีห์, หมากฟ้า
อนึ่ง คำว่า เลมอน (lemon) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลส้มอีกชนิดหนึ่ง ที่หัวท้ายมน ไม่ใช่ผลกลมอย่างมะนาวที่เรารู้จักกันดี สำหรับ มะนาวเทศ (Triphasia trifolia) นั้น เป็นพืชในวงศ์เดียวกัน (Rutaceae) กับมะนาว แต่ต่างสกุล ส่วน มะนาวควาย หรือ ส้มซ่า (Citrus medica Linn. Var. Linetta.) เป็นพืชสกุลส้มเช่นเดียวกัน แต่ต่างชนิด (สปีชีส์) กัน
ส้มนาวเป็นภาษาใต้ที่ใช้เรียกมะนาว เช่นเดียวกับทางภาคอีสานเรียกผลไม้บางอย่างว่า"บัก"ในการขึ้นต้น เช่นบักม่วงที่หมายถึงมะม่วง คำว่าส้มในภาษาใต้จะใช้เรียกผลไม้บางชนิดที่มีรสเปรี้ยว อย่าง ส้มนาว ส้มขาม เป็นต้น
พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย
มะนาวไข่ ผลกลม หัวท้ายยาว มีสีอ่อนคล้ายไข่เป็ด ขนาด 2-3 เซนติเมตร เปลือกบาง
มะนาวแป้น ผลใหญ่ ค่อนข้างกลมแป้น เปลือกบาง มีน้ำมาก นิยมใช้บริโภคมากกว่าพันธุ์อื่นๆ
มะนาวหนัง ผลอ่อนกลมยาวหัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะกลมค่อนข้างยาว มีเปลือกหนา ทำให้เก็บรักษาผลได้นาน
มะนาวทราย ทรงพุ่มสวยใช้เป็นไม้ประดับ ให้ผลตลอดปีแต่ไม่ค่อยนิยมบริโภค เพราะน้ำมีรสขมเจือปน
มะนาวพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ มะนาวฮิตาชิ, มะนาวหวาน, มะนาวปีนัง, มะนาวโมฬี, มะนาวพม่า, มะนาวเตี้ย และมะนาวหนัง เป็นต้น (มะนาวบางพันธุ์อาจเรียกได้หลายชื่อ แต่ในที่นี้ไม่ได้สืบค้นเพื่อจำแนกเอาไว้)
สรรพคุณทางยา
มะนาวเป็นผลไม้ที่มีกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดซิตริก กรดมาลิค ไวตามินซี จากน้ำมะนาว ส่วนน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาว มีไวตามินเอ และซี ทั้งยังมีธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในน้ำมะนาวอีกด้วย
มะนาวมีประโยชน์ใช้เป็นยาสมุนไพร ขับเสมหะ แก้ไอ เลือดออกตามไรฟัน เหงือกบวม นอกจากนี้ยังช่วยแก้อาการปวดศีรษะ แก้อาเจียน เมาเหล้า ขจัดคราบบุหรี่ บำรุงตา บำรุงผิว เป็นต้น
สำนวนเกี่ยวกับมะนาว
มะนาวไม่มีน้ำ : หมายถึง พูดไม่น่าฟัง ไม่ไพเราะ ไม่รื่นหู ห้วนๆ ขาดความนุ่มนวล
องุ่นเปรี้ยว มะนาวหวาน : (จากนิทานอีสป แต่ใช้กันมานาน จนรู้สึกราวกับเป็นสำนวนไทยแท้) หมายถึง เลี่ยงที่จะยอมรับในสิ่งที่ตนต้องการ เนื่องจากไม่ประสบความสำเร็จ หรือเป็นไปไม่ได้ และยอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการแทน
นอกจากนี้ยังมีการเล่นของเด็ก เรียกว่า "ซักส้าว" ที่มีเนื้อร้องกล่าวถึง "มะนาว" ดังนี้
ซักส้าวเอย มะนาวโตงเตง
ขุนนางมาเอง จะเล่นซักส้าว
มือใครยาวสาวได้สาวเอา มือใครสั้นเอาเถาวัลย์ต่อเข้า
บ้างก็ว่า
ซักส้าวเอย มะนาวโตงเตง ขุนนางมาเอง ว่าจะเล่นซักส้าว
 La légende rapporte que le Japon fut fondé au VIIe siècle av. J.-C. par l’empereur Jimmu. Le système d’écriture chinois, ainsi que le bouddhisme furent introduits durant les Ve et VIe siècles par les moines bouddhistes chinois et coréens, initiant une longue période d’influence culturelle chinoise. Les empereurs étaient les dirigeants symboliques, alors que le véritable pouvoir était le plus souvent tenu par les puissants nobles de la Cour, régents ou shogun (général en chef des armées).
La légende rapporte que le Japon fut fondé au VIIe siècle av. J.-C. par l’empereur Jimmu. Le système d’écriture chinois, ainsi que le bouddhisme furent introduits durant les Ve et VIe siècles par les moines bouddhistes chinois et coréens, initiant une longue période d’influence culturelle chinoise. Les empereurs étaient les dirigeants symboliques, alors que le véritable pouvoir était le plus souvent tenu par les puissants nobles de la Cour, régents ou shogun (général en chef des armées).
À partir du XVIe siècle, des commerçants venus du Portugal, d’Espagne, des Pays-Bas et d’Angleterre débarquèrent au Japon avec des missionnaires chrétiens. Pendant la première partie du XVIIe siècle, le shogunat craignit que ces missionnaires fussent la source de périls analogues à ceux que subirent ses voisins (telles les prémices d’une conquête militaire par les puissances européennes ou un anéantissement total, pareil à celui que subit le royaume tibétain de Gugé en 1630 suite à l'accueil bienveillant de missionnaires chrétiens par son roi, accueil provoquant l'invasion du Ladakh par son voisin rival, qui profita de l'agitation engendrée par la colère des autorités bouddhistes contre la menace de la perte de leur monopole religieux et de leur influence); aussi la religion chrétienne fut formellement interdite en 1635 sous peine de mort sous la torture. Puis, en 1639, le Japon cessa toute relation avec l’étranger, à l'exception de certains contacts restreints avec des marchands chinois et hollandais à Nagasaki (長崎), précisément sur l’île de Dejima (出島).
Cet isolement volontaire de deux siècles dura jusqu’à ce que les États-Unis, avec le commodore Matthew Perry, forcent le Japon à s’ouvrir à l’Occident par la politique de la canonnière en signant la Convention de Kanagawa en 1854 après le pilonnage des ports japonais.
En seulement quelques années, le renouement de contacts intensifs avec l’Occident transforma profondément la société japonaise. Le shogunat fut forcé de démissionner et l’Empereur fut remis au pouvoir.
La restauration Meiji de 1868 initia de nombreuses réformes. Le système de type féodal et les samouraï furent officiellement abolis et de nombreuses institutions occidentales furent adoptées. De nouveaux systèmes juridiques et de gouvernement ainsi que d’importantes réformes économiques, sociales et militaires transformèrent le Japon en une puissance régionale. Ces mutations donnèrent naissance à une forte ambition qui se transforma en guerre contre la Chine (1895) et contre la Russie (1905), dans laquelle le Japon gagna la Corée, Taiwan et d’autres territoires.
L’expansionnisme militaire du Japon avait débuté dès le début du XXe siècle avec l’annexion de la Corée en 1910. Il prit de l'ampleur au cours de l’ère Shôwa avec l’invasion de la Mandchourie en 1931 puis des provinces du nord de la Chine. En 1937, l'empire se lança dans une invasion à grande ampleur de la Chine qui débuta avec le Bombardement stratégique de Shanghai et de Guangzhou, entraînant une résolution de blâme de la Société des nations à l’encontre du Japon mais surtout un écrasement du Kuomingtan. Plus de deux cent mille civils chinois furent exterminés lors du massacre de Nankin (Nanjing) par l'armée impériale japonaise.
L’attaque de Pearl Harbor dans l’archipel d’Hawaii en 1941, visant à détruire toute la flotte de guerre américaine, engagea l'Empire dans la Seconde Guerre mondiale. Le Japon agrandit dès lors encore son emprise jusqu'à occuper la Birmanie, la Thaîlande, Hong-Kong, Singapour, l'Indonésie, la Nouvelle-Guinée et l'essentiel des îles du Pacifique. Ce gigantesque empire militaire, appelé officiellement Sphère de coprospérité de la grande Asie orientale, était destiné à servir de réservoir de matières premières. L'occupation de ces territoires fut marquée par d'innombrables exactions à l'encontre des populations d'Extrême-Orient, crimes pour lesquels les pays voisins du Japon demandent toujours des excuses ou réparations aujourd'hui.
L' empereur Showa procéda finalement à la reddition de l'empire du Japon le 15 août 1945 après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki et l'invasion soviétique du Manchukuo. Le traité de paix avec la Russie est toujours en négociation, en règlement du problème des îles Kouriles du sud, occupées par cette dernière depuis la fin du conflit.
Le Japon dévasté après-guerre, et occupé par les troupes du gouverneur de guerre Mac Arthur, confiné à l’archipel, resta sous la tutelle des États-Unis jusqu’en 1951 (traité de San Francisco). Ceux-ci imposèrent une nouvelle constitution, plus démocratique, et fournirent une aide financière qui encouragea le renouveau du pays.
L’économie se rétablit rapidement et permit le retour de la prospérité dans l'archipel suite aux Jeux Olympiques de Tokyo et au lancement du Shinkansen en 1964.
Depuis les années 50 jusqu'aux années 80, le Japon connaît une apogée culturelle et pour le moins économique et une formidable croissance. Toutefois, ce « miracle économique » prend fin au début des années 1990, date à laquelle la bulle spéculative japonaise éclate.

ถนนเยาวราช (Thanon Yaowarat) เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีระยะทางตั้งแต่วงเวียนโอเดียน ถนนเจริญกรุง ในท้องที่แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนทรงสวัสดิ์ (สี่แยกเฉลิมบุรี) ถนนราชวงศ์ (สี่แยกราชวงศ์) และถนนจักรวรรดิ (สี่แยกวัดตึก) ข้ามคลองรอบกรุง (สะพานภาณุพันธุ์) เข้าสู่ท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร สิ้นสุดที่แยกถนนพีระพงษ์ตัดกับถนนมหาไชยและถนนจักรเพชร
บริเวณถนนเยาวราชนี้มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นย่านการค้า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ด้วย บางครั้งก็เรียกบริเวณนี้ตามชาวต่างชาติว่า "ไชน่าทาวน์ (China Town)"
[แก้] ประวัติ
ถนนเยาวราชเป็นถนนที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการถนนอำเภอสำเพ็งซึ่งเป็นนโยบายสร้างถนนในท้องที่ที่เจริญแล้วเพื่อส่งเสริมการค้าขาย สำเพ็งเป็นย่านการค้าที่เจริญมากแห่งหนึ่งนอกเหนือจากบริเวณถนนเจริญกรุงแล้ว ทำให้มีพระราชดำริที่จะสร้างถนนให้มากขึ้น ถนนเยาวราชเป็น 1 ใน 18 ถนนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ขณะดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ) เสนอให้สร้าง เช่น ถนนจักรวรรดิ ถนนราชวงศ์ ถนนอนุวงศ์
ถนนเยาวราชเริ่มตั้งแต่คลองรอบกรุงตรงข้ามกับป้อมมหาไชย ตัดลงไปทางทิศใต้บรรจบกับถนนราชวงศ์ซึ่งสร้างแยกจากถนนเจริญกรุงตรงไปฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าราชวงศ์) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กราบบังคมทูลว่าจะสร้างถนนใน พ.ศ. 2434 โดยให้ชื่อถนนว่า "ถนนยุพราช" ต่อมาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "ถนนเยาวราช" และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 ได้มีพระบรมราชโองการให้ออกประกาศกรมโยธาธิการแจ้งให้ราษฎรทราบว่า การตัดถนนเยาวราชเนื่องจากมีพระราชประสงค์จะให้บ้านเมืองเจริญและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อมิให้ราษฎรพากันตกใจขายที่ดินไปในราคาถูก เพราะเข้าใจว่าจะซื้อเป็นของหลวง หรือบางทีเข้าใจว่าการชิงขายเสียก่อน ถึงจะได้ราคาน้อยก็ยังดีกว่าจะสูญเปล่า และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตึกที่ยื่นล้ำเข้ามาในแนวถนนไม่เกินกว่า 1 วา ไม่ต้องรื้อถอนด้วย
ถนนเยาวราชเมื่อแต่ก่อน
ปรากฏในเอกสารของกรมโยธาธิการว่าเมื่อเจ้าพนักงานไปวัดที่ตัดถนนบริเวณตำบลตรอกเต๊านั้น ราษฎรร้องเรียนว่าเจ้าพนักงานไม่ยุติธรรม เพราะถ้าวัดปักไม้ถูกบ้านของผู้มีบรรดาศักดิ์ก็จะเลี่ยงไปปักที่ใหม่ ถูกแต่ที่ราษฎรทั้งสิ้น ทำให้แนวถนนไม่ตรง ราษฎรที่ตรอกเต๊าจึงมีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์จึงเสนอให้มีเงินค่าเวนคืนที่ดินหรือคำทำขวัญขึ้นเช่นเดียวกับที่คนในบังคับต่างประเทศได้รับ โดยได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเมื่อ พ.ศ. 2437 และได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าปรึกษาในที่ประชุมรัฐมนตรีสภา ซึ่งมีพระราชดำรัสว่า "ถนนสายเดียวซึ่งผู้ที่ไม่ได้ขัดขวางยอมให้ทำล่วงไปแล้วจะไม่ได้รับรางวัล จะได้แต่ผู้ที่ร้องขัดขวางเช่นนี้ก็เป็นที่น่าสงสารอยู่" แต่อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเห็นชอบในการจ่ายค่าที่ดินแก่คนไทยเช่นเดียวกับคนในบังคับต่างประเทศ เพื่อคนไทยจะได้ไม่เสียเปรียบคนต่างประเทศ
การสร้างถนนเยาวราชประสบอุปสรรคหลายประการนับแต่เริ่มกรุยทางในปี พ.ศ. 2435 จนถึงปี พ.ศ. 2438 ก็ยังไม่เสร็จ เพราะนอกจากราษฎรจะขัดขวางแล้วยังปรากฏว่า เจ้าของที่ดินหลายรายขวนขวายที่จะขายที่ดินให้กับคนในบังคับต่างประเทศ ทำให้การก่อสร้างค่อนข้างล่าช้า เพราะกระทรวงนครบาลไม่อาจจัดการเรื่องที่ดินที่ถนนจะต้องตัดผ่านให้กับกรมโยธาธิการได้ ปรากฏว่าพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการได้มีหนังสือกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาลเกี่ยวกับการมอบที่ดินที่อยู่ในแนวถนนให้กระทรวงโยธาธิการ ขอให้กระทรวงนครบาลจัดการในกรณีที่คนในบังคับต่างประเทศจะมาทำหนังสือซื้อขายหรือจำนำที่ดินที่ได้กรุยทางสร้างถนนเยาวราชไว้โดยสั่งให้เจ้าพนักงานหรืออำเภอกำนันให้ทราบว่าเป็นที่ทำถนนอย่าให้รับทำหนังสือซื้อขาย "ขอกระทรวงเมืองได้โปรดประทานพระอนุญาตให้ราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินไปโดยสดวกด้วย" แต่กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์ทรงอ้างว่าต้องทรงรอคำวินิจฉัยจากที่ประชุมเสนาบดีในเรื่องที่ราษฎรร้องเรียนกันขึ้นมาว่าการตัดถนนผ่านที่ดินเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม และปรากฏหนังสือโต้ตอบกันระหว่างเสนาบดีทั้ง 2 กระทรวงนี้ เพราะกระทรวงโยธาธิการก็ต้องการสร้างถนนให้เสร็จสิ้น ขณะที่กระทรวงนครบาลพยายามที่จะให้ราษฎรได้รับเงินค่าที่ดินจากรัฐบาล จึงรอพระบรมราชโองการเกี่ยวกับเรื่องนี้ และยังไม่มอบที่ดินให้กระทรวงโยธาธิการ ถึงกับกรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิธาดาทรงระบุว่า กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์ทรงพระเมตตากับราษฎรบริเวณถนนเยาวราชกว่าราษฎรในแนวถนนอื่น ๆ กรมโยธาธิการจึงต้องดำเนินการสร้างถนนส่วนที่ไม่มีปัญหาและที่ดินที่เป็นของหลวงก่อน
ถนนเยาวราชเมื่อมีการจัดเป็นพื้นที่ถนนคนเดิน
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2441 ปัญหาเรื่องที่ดินซึ่งจะต้องตัดถนนผ่านก็ยังไม่ยุติ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้กระทรวงโยธาธิการดำเนินการตัดถนนต่อไป เพราะมีพระราชดำริว่าที่ดินซึ่งถูกตัดถนนผ่านไปนั้น ย่อมทวีราคาขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายสิบเท่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าของมาก ไม่ควรจะเสียดายที่ดินซึ่งเป็นท้องถนนแต่เพียงเล็กน้อย เพราะรัฐบาลที่ลงทุนทำถนนก็ไม่ได้เก็บเงินค่าคนหรือรถม้าที่เดินบนถนนเลย เพื่อบำรุงการค้าขายให้สะดวก เจ้าของจึงไม่ควรหวงแหน และโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์และกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดาปรึกษากันต่อหน้าพระที่นั่งว่าจะทำอย่างไรให้การตัดถนนสายนี้สำเร็จลงได้ กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์จึงทรงรับที่จะออกประกาศให้เจ้าของที่ดินออกจากที่ดิน หากเจ้าของที่ดินไม่ยอมรื้อก็ให้กระทรวงโยธาธิการแจ้งไปที่กระทรวงนครบาล และให้กระทรวงนครบาลเป็นผู้ให้กรมอัยการฟ้อง ทำให้การตัดถนนเยาวราชดำเนินการต่อไปได้
เมื่อแรกตัดถนนเยาวราชใหม่ ๆ นั้น มีชาวจีนอยู่อาศัยกันหนาแน่น แม้ต่อมาถนนเยาวราชก็ยังคงมีความสำคัญ เพราะเป็นย่านร้านอาหารชั้นนำ ตึกที่สร้างสูงที่สุดตึกแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ก็สร้างที่ถนนเยาวราชเป็นแห่งแรก ช่วงปี พ.ศ. 2500 ถนนเยาวราชรถยังวิ่งสวนทางกัน มีรถเมล์สาย 23 หรือที่เรียกกันว่า "เมล์แดง" และรถเมล์สาย 24 ที่เรียกกันว่า "ไทยประดิษฐ์" วิ่งสวนทางกัน และมีรถรางวิ่งอยู่อีกช่องทางหนึ่ง
ถนนเยาวราชจะเป็นที่จัดงานประจำปีอยู่เนือง ๆ โดยจะปิดการจราจรชั่วคราว เป็น "ถนนคนเดิน" มีการขายอาหารจีนที่มีชื่อ การแสดง และออกร้านมากมายจากร้านค้าที่อยู่สองข้างทาง
 Un appareil photographique se compose au moins d'une chambre noire, avec d'un côté une ouverture pour faire entrer la lumière émise par la scène à photographier et de l'autre une surface sensible pour enregistrer cette lumière.
Un appareil photographique se compose au moins d'une chambre noire, avec d'un côté une ouverture pour faire entrer la lumière émise par la scène à photographier et de l'autre une surface sensible pour enregistrer cette lumière.
Dans le cas le plus fréquent, un objectif est positionné au niveau de l'ouverture. Le plus souvent, il contient un diaphragme permettant de doser la quantité de lumière qui entre, ainsi que la profondeur de champ (ces deux aspects étant liés). Certains objectifs (des modèles simples pour amateurs ou les objectifs catadioptriques) utilisent des ouvertures fixes.
Il existe quelques appareils qui n'utilisent pas d'objectif : les sténopés. Seule une ouverture minuscule permet la formation d'une image relativement nette, ce qui empêche de faire entrer une forte quantité de lumière et aboutit donc à des temps de pose longs. D'où l'intérêt de l'objectif : faire entrer beaucoup plus de lumière (et obtenir une image plus nette).
On installe aussi la plupart du temps un obturateur qui permet de contrôler le temps d'exposition de la surface sensible. Certaines vieilles chambres s'en passent : l'opérateur (le photographe) enlève juste un bouchon devant l'objectif le temps de la pose - mais cela est valable surtout pour les longues poses, couramment employées aux débuts de la photographie, en accord avec la lenteur des émulsions d'alors.
Les surfaces sensibles utilisées procèdent de 2 grandes familles : l'argentique et le numérique. Dans le premier cas, on utilise une émulsion de gélatine et de sels d'argent couchée sur une plaque de verre ou une pellicule, dans le deuxième un capteur (les images sont alors enregistrées sur un support électronique distinct du capteur, le plus souvent une carte mémoire).